- Kaat Philippe, doctorante en Psychologie au Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, à Dijon.

Kaat étudie les liens entre les comportements alimentaires des jeunes enfants et les pratiques éducatives des parents en matière d’alimentation. Elle a notamment réalisé une étude sur l’alimentation des jeunes enfants pendant le confinement du printemps dernier.
- Clémentine Durand-Bessart, doctorante en Ecologie au laboratoire Biogéosciences, à l’université de Bourgogne
Clémentine cherche à découvrir quels animaux mangent quels fruits dans les forêts tropicales africaines. Pour cela, elle a compilé beaucoup d’études scientifiques déjà existantes et elle est partie au Gabon interroger les populations qui vivent sur place.
- Lucile Girard, jeune chercheuse en Sociologie au Centre Georges Chevrier de l’université de Bourgogne
Lucile étudie les parcours professionnels infirmiers, en réalisant des entretiens. Son but est de comprendre comment certaines personnes s’engagent dans la profession infirmière.
- Morgane Dubied, doctorante en Paléontologie au laboratoire Biogéosciences, à l’université de Bourgogne
Morgane s’intéresse à la forme des crânes de rongeurs, pour découvrir si toutes les espèces de rongeurs ont la même forme de crâne à la naissance. Elle essaye aussi de comprendre la manière dont les rongeurs obtiennent leur crâne adulte.
- Cécile Jacques, doctorante en Agroécologie à l’INRAe de Dijon
Cécile travaille dans une équipe spécialisée dans la culture du pois. Elle compare les stratégies que développe cette plante si elle manque d’eau au début ou à la fin de sa croissance.
- Giulia Lelli, doctorante en Philosophie à l’université de Lyon et chargée d’enseignement à l’université de Bourgogne.
Giulia s’intéresse à la manière dont les morts continuent d’exister dans nos mémoires et à travers les productions qu’ils ont laissé. Pour cela, elle réalise notamment des entretiens et analyse des journaux de deuil.
- Karine Montabord, doctorante en Histoire de l’Art à l’université de Bourgogne
Karine cherche à déterminer le rôle accordé à la danse dans le mouvement intellectuel et artistique Dada, au début du XXème siècle. Elle étudie notamment comment la présence de danseur·euse·s et chorégraphes dans les cercles d’artistes a pu influencer la production artistique des dadaïstes.
- Lenny Boquet, doctorant en Archéologie à l’université d’Amiens, basé à Dijon
A partir d’analyses d’os humains découverts sur des sites de fouilles archéologiques, Lenny compare l’état de santé des personnes qui ont vécu en ville ou à la campagne il y a 400 ans.
- Théo Accogli, doctorant en Biologie-santé dans le laboratoire INSERM « Lipides – Nutrition – Cancer » à Dijon
Théo cherche à renforcer notre système immunitaire pour mieux détecter les cancers : en aidant certaines cellules à repérer les cellules cancéreuses cachées dans notre corps, cela pourrait en alerter d’autres pour détruire le cancer.





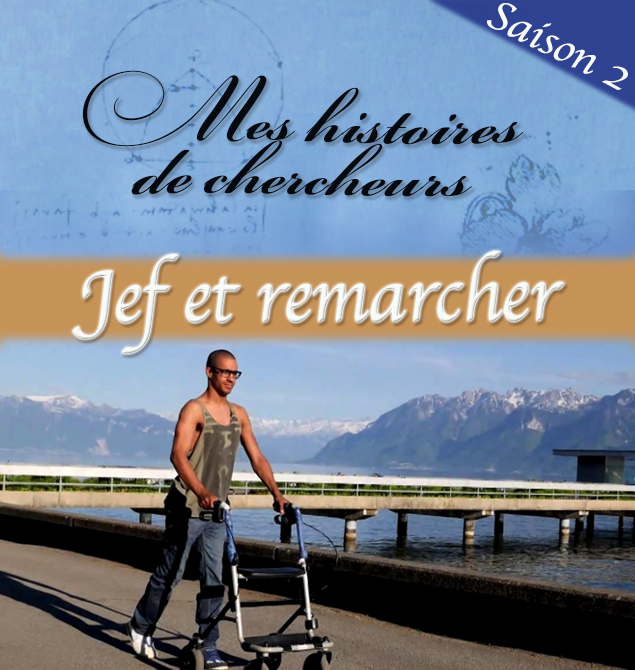
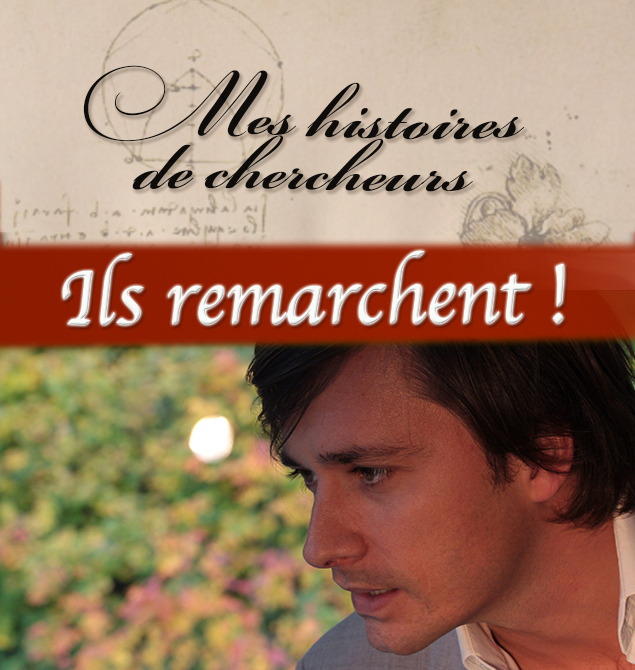
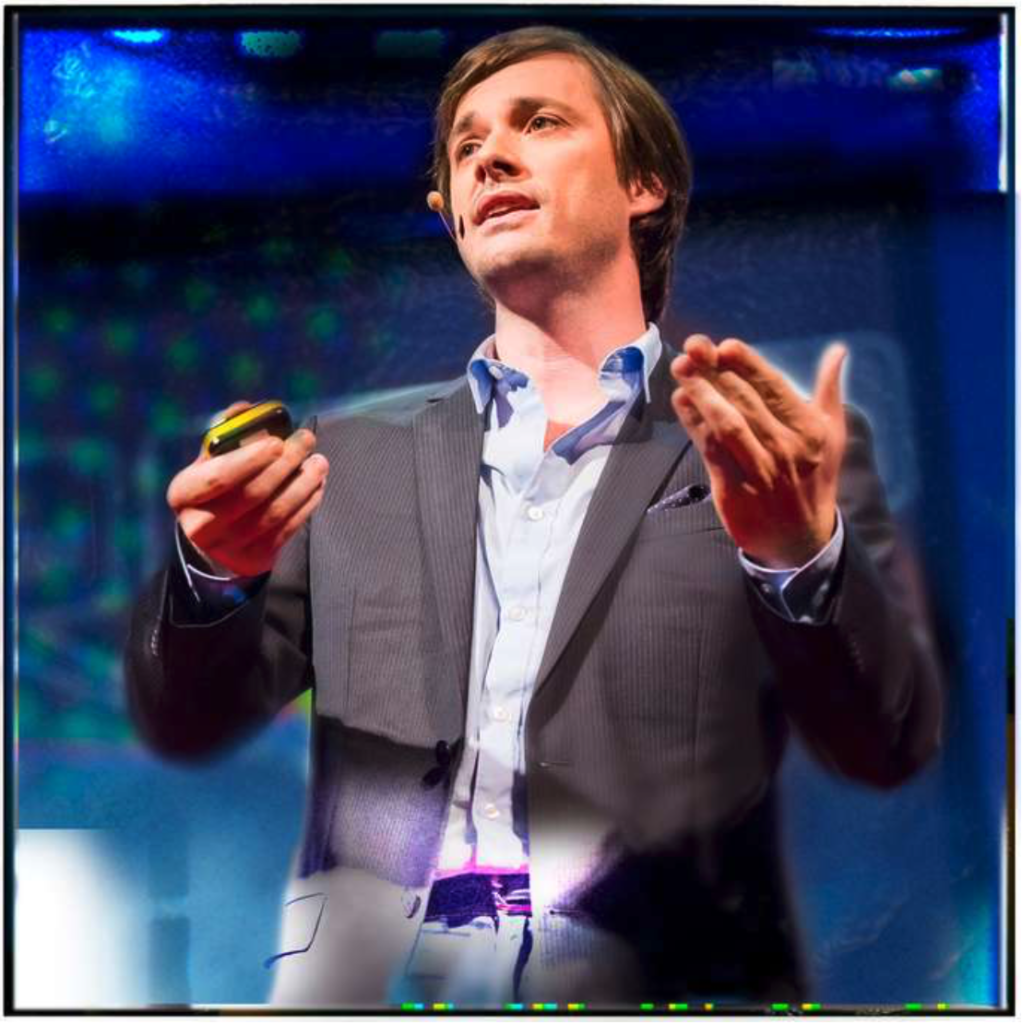
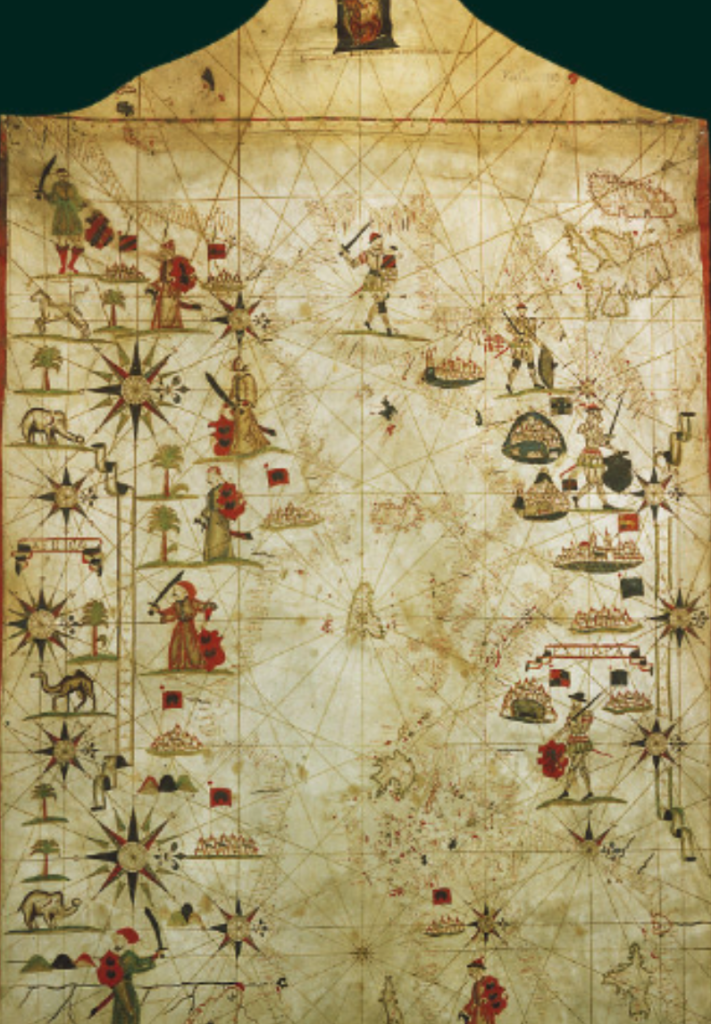

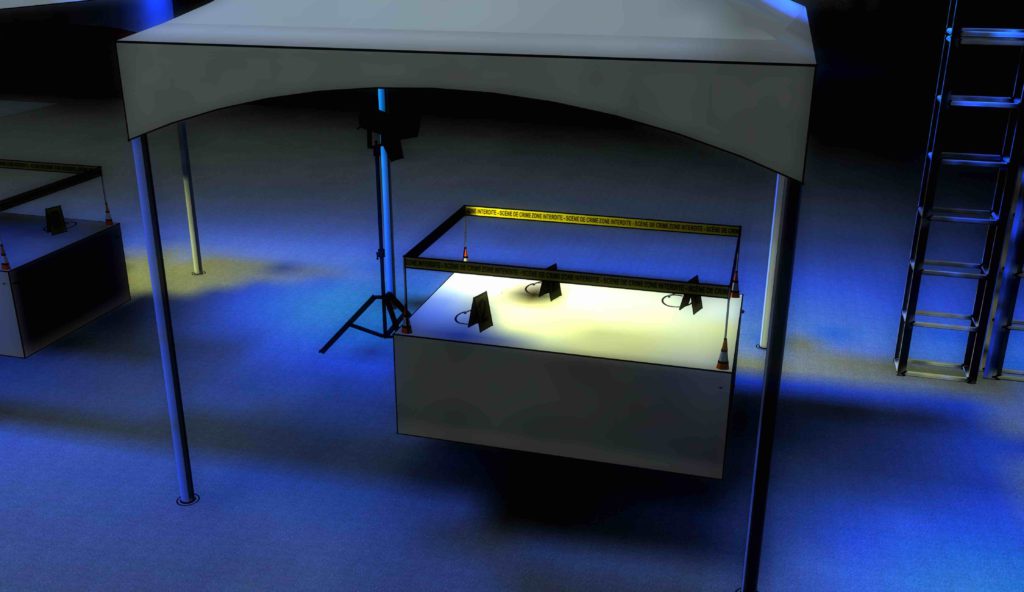

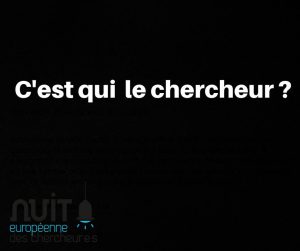 Des histoires de recherche dans le noir ?
Des histoires de recherche dans le noir ?  Mohammed Amine Bendahou, jeune chercheur en cancérologie, à Rabat va relever un défi spécialement pour la Nuit Européenne des Chercheurs à Dijon : raconter, en 3 minutes « top chrono », l’histoire de sa thèse ! Biologiste Mohammed Amine Bendahou travaille sur la « caractérisation moléculaire des gliomes chez le patient marocain adulte et l’identification des gènes impliqués dans l’astrocytome grade II et III et l’oligodendrogliome grade II et III ». Incompréhensible direz-vous ? Attendez !
Mohammed Amine Bendahou, jeune chercheur en cancérologie, à Rabat va relever un défi spécialement pour la Nuit Européenne des Chercheurs à Dijon : raconter, en 3 minutes « top chrono », l’histoire de sa thèse ! Biologiste Mohammed Amine Bendahou travaille sur la « caractérisation moléculaire des gliomes chez le patient marocain adulte et l’identification des gènes impliqués dans l’astrocytome grade II et III et l’oligodendrogliome grade II et III ». Incompréhensible direz-vous ? Attendez ! Découvrir la cause d’une maladie, c’est pouvoir apporter un début de réponse aux familles malades, mais aussi mieux comprendre le fonctionnement de l’organisme, et parfois mieux le soigner » Ainsi débute l’histoire d’Ange-Line Bruel, jeune chercheuse en génétique. Son équipe de recherche, composée de chercheurs et de médecins, enquête sur l’origine de maladies qui provoquent une ou plusieurs malformations chez le bébé : les maladies génétiques.
Découvrir la cause d’une maladie, c’est pouvoir apporter un début de réponse aux familles malades, mais aussi mieux comprendre le fonctionnement de l’organisme, et parfois mieux le soigner » Ainsi débute l’histoire d’Ange-Line Bruel, jeune chercheuse en génétique. Son équipe de recherche, composée de chercheurs et de médecins, enquête sur l’origine de maladies qui provoquent une ou plusieurs malformations chez le bébé : les maladies génétiques. Parfois, il apparait une « faute d’orthographe » dans le gène. Le mot devient incorrect, et le gène est alors abîmé : c’est une mutation. Chaque individu possède des centaines de mutations, mais, parfois elles peuvent être responsables de maladies : c’est ce qu’on appelle les maladies génétiques.
Parfois, il apparait une « faute d’orthographe » dans le gène. Le mot devient incorrect, et le gène est alors abîmé : c’est une mutation. Chaque individu possède des centaines de mutations, mais, parfois elles peuvent être responsables de maladies : c’est ce qu’on appelle les maladies génétiques.